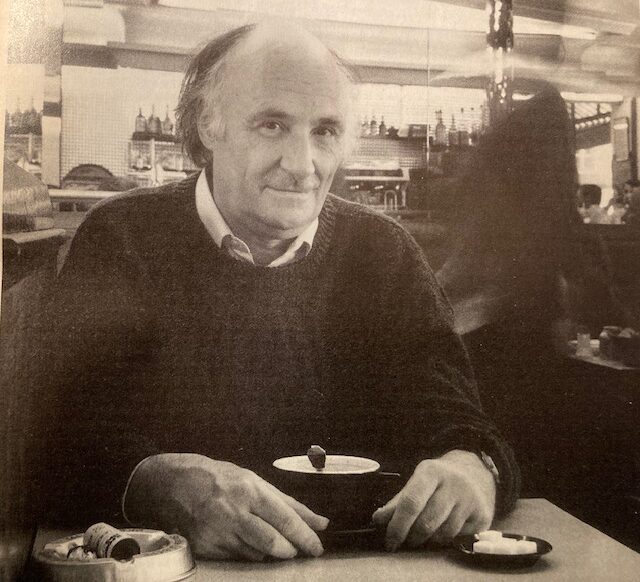Nature writing : de Thoreau aux écrivains français contemporains
Depuis la publication par Thoreau de Walden ou la vie dans les bois, récit de son expérience dans et avec la nature, un genre littéraire, le Nature Writing, est né.

La réplique de la cabane construite par Thoreau, scrupuleusement décrite dans ses notes, est toujours préservée au bord du lac de Walden (Massachusetts) et la préservation des bois autour de Walden fait l’objet de projets spécifiques : l’héritage de l’initiateur du « Nature Writing » est ainsi protégé et ses textes sont rassemblés, édités ou réédités, traduits, étudiés, mais surtout leur énergie parcourt jusqu’aux œuvres d’écrivains français contemporains
Introduction
Le 4 juillet 1845, l’écrivain Henry David Thoreau s’installe dans la cabane construite de ses mains au bord de Walden Pond, un étang de 25 hectares situé à deux kilomètres de la petite ville de Concord, dans le Massachusetts, pour y faire l’expérience provisoire d’une « vie de simplicité et de sincérité avec la nature, et en harmonie avec sa grandeur et sa beauté », à la recherche du soi et d’un mode d’écriture permettant au poète « à la fois de s’exprimer lui-même et d’exprimer la nature », voie d’ouverture spirituelle.
Ce geste s’est révélé fondateur, bien au-delà de son époque et de son cadre géographique. Il a initié l’adoption volontaire d’un mode d’existence et d’appréhension du réel fondé sur une mise à l’écart des villes industrielles, de la société, de ses règles et de son superflu, par des hommes et des femmes conscients de la nécessité de changer leur rapport au monde. Quant au projet d’écriture inséparable de cette quête, après sept ans de travail d’ordonnancement et de réécriture des matériaux accumulés, il a abouti à la publication de Walden ou la vie dans les bois, qui a inauguré une forme littéraire hybride, autobiographique, poétique, philosophique, scientifique et politique, dont la nature est le personnage principal : le nature writing.
Alors que Thoreau s’installe à Walden, Herman Melville rentre aux Etats-Unis après plusieurs années passées sur des baleiniers, et se met à l’écriture de Moby Dick (publié en 1851), exploration des profondeurs de l’âme humaine à travers une ode à la mer et à la mythique baleine blanche ; Nathaniel Hawthorne, lui, écrit La Lettre écarlate (1850), roman dont de nombreux passages célèbrent avec lyrisme le caractère sauvage de la nature ; dans Feuilles d’herbe (1855), le poète Walt Whitman cherche à entretenir un nouveau type de relation avec les puissances naturelles, au-delà de la simple projection des sentiments humains nourrissant la poésie des romantiques européens. « J’ai évité, écrit Whitman dans ses carnets, de faire comme tout homme qui tend à les poétiser, parce qu’elles sont trop grandes pour ce traitement purement formel ». Il entre ainsi en résonance avec la vision transcendantaliste de l’univers élaborée par le philosophe Ralph Waldo Emerson.
Le caractère sublime de la nature
Les idées et la forte personnalité de cet ancien pasteur unitarien installé à Concord, ville natale de Thoreau, sont le point de convergence entre ces auteurs américains accomplissant le vœu qu’il a formulé dans une conférence, en 1937 (note 1) : il a exhorté les intellectuels à s’affranchir de la tutelle culturelle européenne et à créer une littérature nationale en devenant des « Hommes pensants », engagés dans le spectacle de la Nature permettant d’accéder au sublime, dans l’exploration de leur propre nature et dans l’acquisition de la confiance en soi, condition de l’indépendance et de la liberté.
Emerson a posé les principes idéalistes et individualistes du transcendantalisme dans l’essai The Nature (1836), selon lequel « tout phénomène naturel est le symbole de quelque phénomène spirituel » et « la vérité, la bonté et la beauté ne sont que des aspects différents du même Tout » (note 2), absolu et universel. Tout être humain peut y avoir accès, à travers des expériences intuitives auxquelles ouvre la contemplation de la Nature. Elles rejoignent celles que le philosophe allemand Kant qualifiait de transcendantales.
Thoreau a dix-neuf ans lorsque Emerson publie The Nature et sa rencontre avec le philosophe est décisive. Une amitié réciproque les unit et Thoreau suit le conseil de son aîné : tenir un journal qui devient le socle de son entreprise – littérature et expériences de vie mêlées – et la matrice de ses œuvres. Thoreau participe aux activités du Transcendantal Club et écrit dans la revue The Dial. Mais peu enclin aux concessions, Thoreau radicalise les impératifs transcendantalistes : préserver son individualité et son autonomie pour mieux s’engager dans le monde, créer des œuvres nourries de beauté, de vérité et d’éthique pour partager ses expériences et infléchir un changement en profondeur des individus et de la société. Il veut « rendre sa vie digne d’être contemplée à son heure la plus élevée et la plus critique », accéder à la quintessence de l’existence en supprimant les faux besoins et en redonnant toute leur importance aux faits les plus ordinaires : la contemplation d’un lichen ou la mesure de la température de l’eau du lac.
Il s’installe donc à Walden dans une cabane, ouverte sur le dehors, « sans stabilité ni racines », lieu « d’une expérience « fondamentale », expérience du soi et de l’environnement » (note 3), lieu d’expression de la psyché et de l’âme mais aussi de la matérialité des gestes et des choses indispensables à la survie. Il y occupe son temps tout autant à la rédaction de son journal qu’à la culture de son champ de haricots, à des observations de ce qu’on appellerait aujourd’hui « l’écosystème du lac » qu’à des promenades silencieuses pour entrer en communion avec la Nature. Il approche ainsi la compréhension du « grand secret de sa vie » à travers des épiphanies d’ordre mystique. « Mon métier, écrit-il dans son journal, est d’être toujours en alerte pour trouver Dieu dans la Nature ».
L’Amérique est aussi amérindienne
II cherche aussi à se rapprocher du sauvage que chaque homme porte en soi, celui qui s’ancre dans les lieux autrefois habités par les Amérindiens qui entretenaient des rapports « nobles et loyaux avec la nature. Thoreau a toujours été sensible au fait que Concord s’appelait Musketaquid avant l’achat des terres par les premiers colons au sachem Tahatawan. Il a toujours collectionné les pointes de flèches, les traces laissées par ceux dont les descendants venaient toujours à Concord vendre leurs produits d’artisanat ou lui servaient de guide lors de ses marches dans le Maine. Après son départ de Walden, Thoreau réunira 2 800 pages (11 volumes) de notes, The Indian Notebooks, source la plus importante d’informations sur les Indiens au XIXe siècle. Il les a rassemblées en vue de la publication d’un ouvrage sur lequel sa mort en 1862 a laissé planer bien ses conjectures : « Pour Richard Fleck [l’éditeur américain des Indian Notebooks], comme pour Thierry Gillyboeuf (note 4), plutôt que d’écrire l’histoire des Amérindiens, Thoreau entendait peut-être réécrire l’histoire des Américains à travers le prisme de la culture indienne » (note 5), et ainsi leur redonner leur place fondatrice de détenteurs de la mémoire originelle auxquels les Euro-Américains n’avaient pas accès.
Ainsi Thoreau mène-t-il cette quête de la sauvagerie primitive au bord de la civilisation. La terre de Walden appartient à Emerson et est suffisamment proche de Concord pour que Thoreau y revienne fréquemment. La ligne du train récemment mise en service longe le bord du lac. Et dans sa cabane, Thoreau a prévu une chaise pour des visiteurs avec lesquels il entretient de longues discussions philosophiques. Il pêche, il joue de la flute, mais il emporte aussi dans ses promenades un des livres empilés dans sa cabane. S’y côtoient Homère, Platon, Ovide, Goethe, les poètes anglais, Chateaubriand et les textes récemment venus de l’Orient comme la Bhagavad-Gita hindoue ou les poèmes mystiques soufis du perse Saadi : le Divin auquel la Nature donne directement accès outrepasse les clivages entre religions et la démarche de Thoreau vers la Vérité et le Réel lui a valu d’être présenté comme « L’éveillé du Nouveau Monde », dans un essai publié par Gilles Farcet en 1986.
L’expérience de Thoreau à Walden a longtemps connu une postérité un peu souterraine. Il est très fréquemment cité pour ses positions pacifistes et abolitionnistes exposées dans son essai, Résistance au gouvernement civil (plus connu comme De la désobéissance civile), qui a influencé Tolstoï, Gandhi et Martin Luther King.
C’est dans la seconde moitié du XX° siècle que la figure de Thoreau telle qu’elle se révèle dans Walden a été revendiquée comme une référence par ceux qui ont entrepris de sortir des modèles consuméristes, urbains, tournés vers un progrès destructeur de l’environnement et pesants sur le plan moral et religieux. Celui qui avait appris par « son expérience que si l’on avance avec confiance dans la direction de ses rêves, si l’on s’efforce de vivre la vie que l’on a imaginée, on trouvera un succès inattendu dans la vie ordinaire » leur est apparu comme un précurseur. Ils se sont reconnus dans ses principes d’économie frugale, dans sa proximité sensible avec la nature, dans son engagement politique et éthique visant à transformer la société par un changement personnel. Certains d’entre eux (Allen Ginsberg, Gary Snyder) se sont engagés dans la pratique des religions orientales.
« Par-delà les États Unis, Thoreau et ses amis ont mis en mouvement une énergie culturelle dont le jaillissement provoque, ça et là, des trouées », écrit Gilles Farcet qui nomme ces explorateurs des « individualistes cosmiques », individualistes parce qu’ils vont « à la pointe de leur propre singularité », cosmiques « parce que leur individualisme dépasse de beaucoup leur identités respectives […] Chez ces extravagants qui s’aventurent dehors, le particulier débouche toujours sur une sensation plus dense de l’univers ».
Un paganisme mystique
Publiée en 1922, la première traduction de Walden en français par Louis Fabulet compte parmi ses lecteurs Proust, Bachelard ou Giono dont le premier roman choral tire son nom d’un poème de Walt Whitman : Le chant du monde (1934). Il y recrée un univers venu d’un passé immémorial où Antonio, l’homme de la rivière et Matelot l’homme des forêts s’adressent aux arbres, aux plantes, aux animaux, au vent, à l’eau et au ciel comme à leurs congénères. Marqué par un paganisme mystique, Que ma joie demeure (1935) s’ouvre sur la volonté de Bobi, l’acrobate, de changer le monde et le roman construit son avancée autour d’une interrogation fondamentale : la joie simple et primitive peut-elle renaître dans une communauté villageoise vivant dans une forme de pureté originelle et dans un espace ouvert vers l’infini ? Inscrite dans cette dimension cosmique – « la foudre lui planta un arbre d’or dans ses épaules » – la mort de Bobi résonne comme un échec mais Giono donne à cette fin tragique un autre sens : « Ai-je trouvé la joie ? Non. Ce qu’on a appelé pessimisme dans mon livre n’est que franchise. J’ai trouvé ma joie. Et c’est terriblement autre chose. […] J’ai participé à toutes les vies. Je me suis véritablement senti sans frontières. Je suis mélangé d’arbres, de bêtes et d’éléments ; et les arbres, les bêtes et les éléments qui m’entourent sont faits de moi-même autant que d’eux-mêmes. J’ai trouvé pour moi une joie corporelle et spirituelle immense. Tout me porte, tout me soutient, tout m’entraîne. […]. Les orages, le vent, la pluie, les ciels parcourus de nuages éblouissants, je n’en jouis plus comme un homme, mais je suis l’orage, le vent, la pluie, le ciel, et je jouis du monde avec leur sensualité monstrueuse. Et je peux affirmer, contrairement à ce qu’on dit que la matière ne désespère pas. […] Elle [nous offre] une sorte de connaissance totale. […] Les lois de la matière nous obligent à l’espoir. » (note 6) Dieu n’est plus là, mais la fusion avec la nature demeure. Lecteur de Walden, Giono a aussi traduit Moby Dick de Melville. Ce roman le soutient pendant son séjour en prison, suite à ses prises de position pacifistes. Il s’y sent particulièrement proche du Thoreau de la Résistance au gouvernement civil.
En 1961, un passeur de l’œuvre de Thoreau et de Whitman s’installe en France : le poète écossais Kenneth White « se retire au bout du monde [à Gourgounel, en Ardèche] afin d’y communier avec la nature et avec une chèvre poétique ». Dès l’âge de quatorze ans, raconte-t-il, « Thoreau à Walden Pond, se promenant autour de l’étang, c’était pour moi une image… [qui] me parlait très profondément, d’autant plus qu’il partait des mêmes bases que moi : c’est un protestant qui proteste contre le protestantisme. » (note 7) Les Lettres de Gourgounel surgissent en 1966 en Grande-Bretagne puis en 1979 en France, comme un objet littéraire sans correspondance. Il s’agit d’une succession de courts récits à la première personne, journal de l’installation, puis d’un été et d’un automne, dans une maison à l’écart où le poète s’isole pour accomplir son « alchimie mentale », dans la compagnie des pierres, des oiseaux, des artisans tout autant que de Nietzsche, des lettrés chinois et des poètes japonais qu’il étudie à son bureau face au spectacle des orages. Il cherche à « incorporer à sa propre identité et à son écriture » ce qui l’entoure, à « transcendantaliser » par l’écrit les merveilles, rocher ou plante, qu’il découvre.
Ces Lettres de Gourgounel deviennent un emblème pour ceux qui, après mai 1968, cherchent à repenser leur rapport avec et dans le monde, en s’ouvrant vers un dehors dont Kenneth White dessine en 1982 la figure dans l’essai Figure du dehors. Le chapitre intitulé « Marcher avec Thoreau » fait connaître en France l’auteur de Walden, mais aussi de récits de marches à travers les espaces « sauvages » de la Nouvelle-Angleterre. [Thoreau] « est quelqu’un qui en dehors de tous les cadres, suit des pistes et trouve des signes », comme Kenneth White lui-même au long de son parcours géopoétique. Il a récemment suivi de nouveaux chemins de pensée au fil des Vents de Vancouver (2014) ou de la Mer des lumières (2016). Il en a ramené des écrits « d’un autre ordre […] celui des voyageurs de l’esprit, des pèlerins du vide ».
« Vie enfouie, vie terrienne et vie céleste »
C’est en 1972 qu’un de ces « voyageurs de l’esprit », André Bucher a décidé de se retirer dans la vallée du Jabron, pour y accomplir son désir de prendre « en charge son existence de manière plus radicale tout en modifiant son comportement […] grâce à l’agriculture biologique et une pratique écologique », mais aussi de « produire, créer de la beauté et développer une forme d’intelligence du cœur » dans le respect des valeurs éthiques. Pour André Bucher, agriculture et écriture sont les deux pans qui équilibrent une même démarche. Il écrit ses romans aux titres poétiques (Le Cabaret des oiseaux, 2004) « dans et non sur la nature ». Il y déploie « tout l’éventail sociologique » de sa vallée, bûcherons, artisans, paysans, médecin, infirmière, institutrice, personnages de ses récits accordant une large place à l’imaginaire et aux rêves, évitant le tragique, mais pas les drames personnels ni les tensions. Le plus souvent, solidarité et empathie l’emportent : elles sont une règle non écrite dans ces communautés où la solitude peut se révéler, plus qu’ailleurs, mortelle. Avec grâce mais aussi une exactitude scrupuleuse usant de termes rares, il y décrit le lent passage d’un jour sous une tempête de neige (Déneiger le ciel, 2007), ou des saisons dans la vallée où les humains se sentent protégés par le grand cerf, déjà devenu mythique (La vallée seule, 2013). Il y met à égalité les éléments, les animaux et les êtres humains, « apprentis sorciers et rois prédateurs ». Il manifeste un intérêt particulier pour les arbres au pouvoir symbolique : « Vie enfouie, vie terrienne et vie céleste ; la trinité ou le socle d’un état sauvage accordant l’être à la nature, le profane au spirituel, le familier au mystère ». André Bucher « célèbre sans diviniser ». Son essai A l’écart (2016) s’achève sur cette affirmation : « Nous ne sommes pas une espèce privilégiée ni de providentiels élus. Juste des créatures ténues et imparfaites dans la ronde universelle, l’absolu mystère de l’espace et du temps. »
A l’écart, André Bucher l’est aussi par rapport à la société médiatisée et connectée. Il apparaît peu sur les scènes littéraires parisiennes, à l’exact opposé de Sylvain Tesson, né l’année où l’écrivain-paysan s’installait dans la vallée du Jabron. En rupture de multiples manières avec la société, Sylvain Tesson a forgé sa notoriété en explorant les extrêmes, en escaladant les toitures ou en marchant à pied à travers l’Asie centrale, et en publiant récits de voyages, nouvelles, aphorismes et « autres pensées sauvages ». En 2010, il décide de « vivre en ermite au fond des bois » avant qu’il ne soit trop tard : « Le froid, le silence et la solitude sont des états qui demain se négocieront plus chers que l’or ». Il s’installe pour six mois dans une cabane au bord du lac Baïkal, avec des caisses de livres et une de vodka, pour s’y « inventer une vie sobre et belle […] resserrée autour de gestes simples. J’ai regardé les jours passer, face au lac et à la forêt. J’ai coupé du bois, pêché mon dîner, beaucoup lu, marché dans les montagnes et bu de la vodka, à la fenêtre. La cabane était un poste d’observation idéal pour capter les tressaillements de la nature. J’ai connu l’hiver et le printemps, le bonheur, le désespoir et finalement la paix. Au fond de la taïga, je me suis métamorphosé ». Pour accomplir cette transformation du soi, Sylvain Tesson fait donc le choix radical de la Sibérie, d’une rive du Baïkal où les ours sont ses voisins et le premier village à 120 kilomètres. Walden fait bien partie de sa bibliothèque sibérienne, mais le « prêchi-prêcha de parpaillot comptable [de son auteur] le lasse un peu. » Il exclut tout lien avec le religieux ou la transcendance. C’est à sa lecture de Whitman qu’il attribue sa décision de mise à l’écart en se revendiquant de ses prises de position contre l’État : « je n’ai rien à voir avec ce système, pas même assez pour m’y opposer ».
Sylvain Tesson n’a plus d’illusion sur sa capacité à transformer le monde. Mais le livre qu’il a tiré de ses notes, Dans les forêts de Sibérie (2011), rencontre un succès inattendu : 400000 exemplaires vendus. Journal de bord au style direct, aux phrases et dialogues rapides, où se succèdent des éléments variés – le soleil qui déchire les nuages sur le lac gelé, un dialogue avec des ouvriers, des impressions de lectures de Giono, Sade ou Lao-tseu…- rencontre un très large public. Construite autour de son « look d’aventurier », l’image médiatique de Sylvain Tesson insiste sur l’exotisme des situations extrêmes dans lesquelles il évolue et renforce son pouvoir à susciter les rêves. Ses lecteurs s’identifient à cette expérience solitaire qui libère le temps des faux diktats de la vie contemporaine et le transforme en une « procession invisible et légère qui fraie son chemin à travers l’être ». Ils partagent les émotions grandioses que provoque le spectacle de la nature. Même l’agnostique Sylvain Tesson est alors conduit à évoquer une éventuelle présence divine : « Le ciel est fou, ébouriffé d’air pur, affolé de lumière. Des images d’une intense beauté surgissent et disparaissent. Est-ce cela l’apparition d’un dieu ? »
Des aventures intérieures au cœur de la nature en danger
Ce succès s’inscrit dans le contexte d’un engouement en France pour le nature writing qui se manifeste à travers le développement du Festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo, premier salon du livre après celui de Paris. Il accorde une place privilégiée aux auteurs américains qui, à partir des années 1970, se sont rassemblés autour de Missoula, dans le Montana, pour y faire naître une littérature forte, nourrie par les traditions amérindiennes – et les luttes pour leur redonner leur dignité -, par les espaces encore sauvages de l’Ouest des Etats-Unis – et les combats pour les préserver. Relayé par des traducteurs et des éditeurs passionnés, le nature writing trouve souvent plus d’échos en France qu’en Amérique. Dans son récit autobiographique posthume (Le Vieux saltimbanque, 2016) Jim Harrison note que son œuvre littéraire foisonnante est beaucoup plus célébrée en France qu’aux Etats-Unis où il a dû gagner sa vie avec l’écriture de scenarios. Dans sa postface à la traduction française de la biographie de Thoreau, Kenneth White note que « Thoreau a été mieux compris en Europe qu’aux Etats-Unis. » (note 8).
Au moment où les enclaves françaises de « vie sauvage » sont menacées, au moment où Sylvain Tesson, après un accident qui a fallu lui coûter la vie, se régénère, par la marche, Sur les chemins noirs (2016) qui permettent encore de se glisser dans des interstices silencieux, au milieu des « campagnes en miettes », un désir se fait plus impérieux : participer, directement ou à travers la lecture de livres puissants, à des aventures intérieures au cœur de la nature en danger, cette nature qu’Emerson et les transcendantalistes considèrent comme le miroir de l’homme et sa voie d’accès vers le sublime.
Le besoin d’un retour aux sources, au geste fondateur de Thoreau, se traduit par la multiplication des éditions françaises de Thoreau avec, par exemple, l’entreprise monumentale de traduction des 7 000 pages de son Journal, initiée par Thierry Gillyboeuf aux éditions Infinitude. En 2017, deux éditions en format de poche de Walden paraissent simultanément : l’une dans la traduction de Brice Matthieussent préfacée par Jim Harrison et annotée par Michel Granger aux éditions Le mot et le reste, l’autre revivifiant la traduction historique de Louis Fabulet aux éditions Albin Michel.
Notes
- note 1 – L’Intellectuel américain, conférence prononcée le 31 août 1837 par Ralph Waldo Emerson devant la fraternité d’étudiants en lettres d’Harvard « Phi Beta Kappa »
- note 2 – Ralph Waldo Emerson, La Nature, traduit par Patrick Oliete Loscos, éditions Allia, 2011, p. 32 et 30
- note 3 – Gilles A. Thiberghien, Notes sur la nature… la cabane et quelques autres choses, éditions Le Félin, 2008, p. 37
- note 4 – Thierry Gillyboeuf, Henry David Thoreau. Le célibataire de la nature. Paris, Fayard. 2012
- note 5 – Isabelle Courges, « Henry David Thoreau : un anthropologue entre ethnocentrisme », Circé, n°6, mars 2015
- note 6 – Jean Giono, Préface des « Vraies Richesses », in Œuvres Complètes, tome II, Gallimard, Pléiade, p. 1352-1353
- note 7 – « Un anarchiste de l’aurore, dialogue avec Kenneth White », in Gilles Farcet, Henry Thoreau l’éveillé du Nouveau Monde, Albin Michel, Espaces libres, 1986, p. 296
- note 8 – Kenneth White, « Thoreau est revenu chez lui », in Robert Richardson, Henry David Thoreau, biographie intérieure, trad. par Pierre Madelin, Editions Wildproject, 2015, p. 460
Références
- Aliette Armel, « Quand nature résonne avec littérature – De Thoreau aux écrivains français contemporains », Ultreia, été 2017.
Partager cette ressource
Laisser un commentaire
Dernières ressources publiées
Au fil des semaines, j’exhume des pépites de mes dossiers. Elles font résonner la voix d’auteurs célèbres ou/et rares, leurs œuvres entrent en résonance autour de thématiques universelles et, selon la forme utilisée, les éclairages différent.
Pour être informé des dernières nouvelles,
abonnez-vous à la lettre d’info !
Une fois par mois, découvrez l’actualité des ateliers d’écriture, mes nouvelles publications de ressources et les nouveautés de mon journal de bord.