
Roman policier atypique, Les Saules brosse le portrait d’une communauté bouleversée par un meurtre. Interrogatoire après interrogatoire, l’enquête révèle les faces cachées des personnalités, et ce qui, d’ordinaire, demeure enfoui dans le secret.
Le premier roman d’une femme originaire de la campagne
Deux très jeunes filles occupent une place centrale dans Les Saules. Marie, dix-sept ans est retrouvée morte dans la coulée, sous les saules, après une dernière fugue où son désir éperdu de liberté et d’amour se fracasse sur l’égoïsme et la lâcheté masculines. Marguerite, dix ans, la muette, la souillonne à la chevelure sale et inextricable, est considérée partout comme une demeurée, souffre-douleur à l’école comme chez dans sa famille, face à une mère impuissante à élever sa fille. Elle se réfugie derrière sa fenêtre d’où elle voit beaucoup de choses et de gens passer… même celles et ceux qu’il ne faut pas voir.
Quant à Mathilde, l’auteure du livre (dont le prénom commence également par « Ma » !) lorsqu’elle présente Les Saules à la Grande Librairie, elle évoque les « billes d’enfance » apparues dans sa mémoire pendant l’écriture de son roman : le gros chien qui protège Marguerite, le cochon qui passe son grouin sous la porte de l’étable et lui fait peur, le désir de liberté qui l’a animée comme Marie. Mathilde a réussi, elle, son départ à dix-huit ans, ses études, et l’écriture de ce roman où elle assume, enfin, ses origines de fille d’agriculteurs qui lui ont parfois été renvoyées comme une marque honteuse, indélébile.
Des interrogatoires qui gouvernent l’avancée du récit
Mais ce cadre biographique porte un roman à suspense tenant en haleine le lecteur, non seulement par l’intrigue, mais parce qu’il force l’intimité des habitants « de ce patelin vieillissant pour ne pas dire moribond » au fil des découvertes faites par André le capitaine de gendarmerie du village et Arlette, officier de police judiciaire venue d’ailleurs pour arracher au silence « les secrets les plus férocement arrimés ».
Mathilde Beaussault accorde une particulière importance aux interrogatoires en les faisant se succéder avec fluidité et efficacité. Ils sont vivement menés, au fil de questions qu’elle gomme pour éviter toute répétition et lourdeur. Tous les personnages se succèdent ainsi, tous sur le même plan, dressant leur propre autoportrait, guidé par la « main de fer » presque invisible des deux policiers aux méthodes opposées mais concordantes. André ne parvient pas à cacher son humanité profonde, grâce à laquelle il amadoue Marguerite dès leur première rencontre : elle « perçoit toute la douceur de cet homme géant qu’elle ne connaît pas ».
Interrogatoire de Julien
Je ne l’ai pas tuée, si c’est ce que vous voulez savoir ! Je l’ai pas touchée. Vous trouverez rien sur moi parce qu’il y a rien à trouver.
Samedi, j’étais chez moi. Avec ma mère. Vous pourrez lui demander. C’est facile. C’est peut-être ça que vous auriez dû faire d’abord. (Julien claque dans ses mains, renifle fort après sa phrase emphatique qu’il pense plus intelligente que les autres.)
Non, je ne m’énerve pas, je vous dis la vérité. Vous croyez que c’est facile pour moi ? (Il gesticule, assis sur des punaises invisibles.) Tous les gars à la caserne me regardent bizarrement depuis qu’ils savent que je suis obligé de venir ici. Ma mère chiale depuis hier. Et je sais bien que c’est pas à cause des oignons.
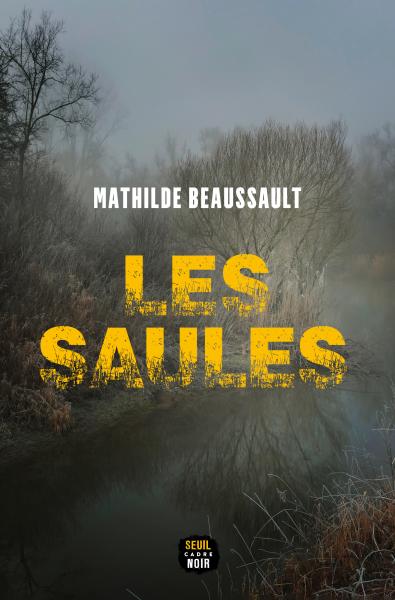
L’âpreté d’une langue efficace
Au village, « On ne dilapide pas son temps. On se croit et on répond présent, les uns pour les autres. » ou on se hait au point d’adopter des comportements d’une dureté extrême : le père de Marguerite a vu le cadavre de Marie, mais il interdit à sa belle-sœur d’alerter la gendarmerie, car les Legrand, les parents de Marie, les riches de la Haute motte, « ne se bougeraient pas le cul si c’était Marguerite sa propre fille qu’était balancée près de la flotte. »
Le langage est âpre, aux formules souvent éblouissantes, comme lorsqu’un chapitre s’ouvre sur l’annonce que « Marguerite a été recrachée par le car » (le bus scolaire). Son efficacité brute, jamais abusivement triviale, est une autre manière de dépeindre la rudesse de ces hommes et femmes passant leur existence à arracher à la terre leur dû.
C’est une écriture sur laquelle on s’attarde, contrairement à celle de la plupart des romans policiers mais qui n’entrave en rien le désir du lecteur de connaître, au final, l’identité du meurtrier.
Références
- Mathilde Beaussault, Les Saules, Seuil-Cadre noir, 272 p., 2025.
Partager cet article
Laisser un commentaire
Vous aimerez peut-être…
Pour être informé des dernières nouvelles,
abonnez-vous à la lettre d’info !
Une fois par mois, découvrez l’actualité des ateliers d’écriture, mes nouvelles publications de ressources et les nouveautés de mon journal de bord.


