
La maîtrise exceptionnelle dont Laurent Mauvignier fait preuve dans la construction de ce récit familial sur quatre générations, suscite l’enthousiasme de la critique, des libraires et des lecteurs depuis la parution de ce roman fin août 2025.
Une succession de rebondissements et d’épisodes imprévisibles
Une succession de rebondissements et d’épisodes imprévisibles
Le flux des phrases amples et cadencées plonge le lecteur dans l’intériorité des personnages, tout en l’entrainant dans une succession de rebondissements et d’épisodes imprévisibles. Ils sont moins liés aux événements extérieurs – par ailleurs très connus (les Guerres mondiales) – qu’aux réactions et interactions, jeux de pouvoir et de dissimulation, de destruction et d’auto-destruction entre les membres de cette famille. Leur violence pousse certains d’entre eux vers la déstabilisation psychique et des conduites irraisonnées menant à des tragédies dont les conséquences se font encore sentir au présent de l’écriture de ce roman par Laurent Mauvignier, leur descendant.
Un « je » pudique, vraie présence dans le récit
Un « je » pudique, vraie présence dans le récit
L’écrivain s’introduit au « je » dans la narration des faits du passé, à travers les objets qu’il retrouve dans la maison vide, les réminiscences de bribes d’histoires arrachées, pendant son enfance, au silence et au secret. Il se glisse dans la psyché tourmentée de ses ancêtres, reconstruit de l’intérieur leur fonctionnement, fait revivre les événements – des plus intimes aux plus Historiques – comme s’il tenait leur récit directement de ceux qui les avaient vécus, ressentis dans leur chair, et leur cœur où, le plus souvent, ne parvient pas à résonner le mot « amour ».
L’ascension d’une lignée
Dans La Maison vide de Laurent Mauvignier, le poids des générations, des règles patriarcales et des convenances sociales, des sentiments tus, des talents détruits et des rêves brisés, mais aussi la violence et la cruauté des conflits interpersonnels, des manifestations de pouvoir et des spoliations, pèse sur la lignée familiale initiée par un aïeul, François Proust. Mort sur « un champ d’honneur » post-révolutionnaire, il est réputé avoir été décoré de la Légion d’honneur par Bonaparte lui-même. Au titre de sa bravoure et de cette décoration, sa femme et sa parentèle ont reçu les titres de propriété de terres abandonnées par la noblesse. Leurs descendants ont pu construire pas à pas leur fortune et une grande maison à La Bassée, bourg imaginaire créé par Laurent Mauvignier pour évoquer – sans la nommer – la campagne tourangelle où il a été élevé.
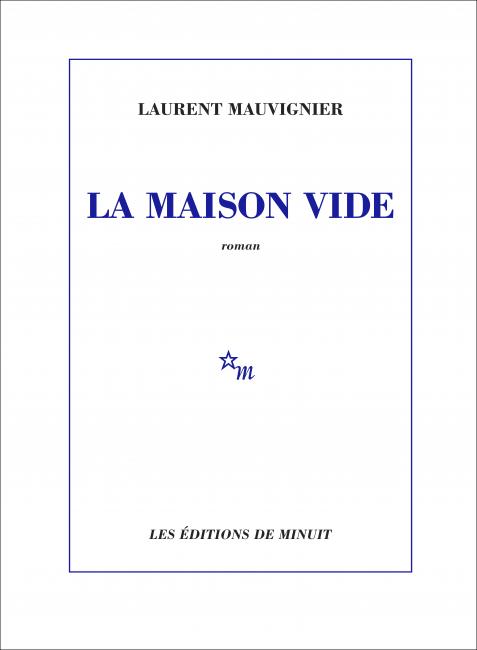
Des hommes au pouvoir et des femmes de décision
Des hommes au pouvoir et des femmes de décision
La famille Proust est donc placée dès son origine sous le signe de l’héroïsme guerrier, d’une veuve oubliée par l’Histoire et d’une fortune liée à des terres mises en fermage, consolidée par Firmin, l’arrière-grand-père de l’auteur, avec la construction d’une scierie et d’une menuiserie. Dans la société française paysanne et bourgeoise du début du XX° siècle, les hommes sont seuls habilités à régler toutes les affaires publiques et privées, financières et juridiques, et à décider du destin de tous les membres de leur famille. La femme de Firmin est ainsi désignée pendant la première partie du livre non par son identité mais par sa fonction d’«ombre préposée aux confitures et aux chaussettes à repriser »«, qui « baissait les yeux et acquiesçait à la parole d’évangile de son époux, mais savait tirer profit de l’obscurité dans laquelle chacun avait l’habitude de la tenir enfermée pour mieux construire, silencieuse et industrieuse, en véritable fourmi obstinée, son espace de liberté ». et participer à toutes les prises de décision À la page 42, Laurent Mauvignier prépare déjà l’inversion de situation auquel se confronte, page 367, Jules, le gendre auquel Firmin a légué, en respectant les conventions et la loi, tous les pouvoirs sur la famille. Lorsqu’il revient en permission en 1916, Jules constate que, malgré son absence, « Quelqu’un tient la maison ». Jeanne-Marie Forabelle épouse Proust, la « préposée aux confitures et aux chaussettes à repriser » n’est plus désormais désignée que comme La Patronne, « et préside à la vie de tous les membres du domaine, « ici et maintenant » !
Marie-Ernestine et Jules, Marguerite et André.
Laurent Mauvignier se livre à une autre forme d’inversion transgressive. Certes ce sont les hommes qui transmettent seuls, à l’époque, le nom et les biens, mais les personnages marquants de la lignée ce sont, pour lui, les femmes : Marie-Ernestine, dite « Boule d’or », fille de Firmin et de « l’ombre préposée aux confitures et aux chaussettes à repriser » puis Marguerite, fille de Marie-Ernestine et de Jules, « le jeune homme trop gros » devenu un héros emblématique de la Première guerre à sa mort, au front, en 1916.
Marie-Ernestine et Marguerite ont tour à tour été vouées au sacrifice de leurs désirs les plus profonds, de leur sensibilité, de leurs élans et talents sur l’autel des décisions implacables prises au nom de la stabilité des affaires et du rang conquis par cette famille, réputée pour son aura singulière mais parfois mortifère. Marie-Ernestine a frôlé la mort dans une tentative de suicide, Marguerite a été condamnée à la solitude du fait de son alcoolisme mais surtout de sa fréquentation d’un allemand pendant la guerre, alors que son mari André était prisonnier en Allemagne. Cette mort sociale est scellée lorsque Marguerite est tondue sur la voie publique, à la Libération.
« Un pauvre petit papa de sept ans »
Cette scène tourne en boucle dans la mémoire de son petit-fils, Laurent Mauvignier, qui s’obstine à croire que son « petit papa de sept ans, qui crie ou pleure ou essaie de rejoindre [sa mère Marguerite], qui s’est enfui de la maison et a traversé seul cette boue humaine […] aura été récupéré avant […] par n’importe qui ayant un peu l’intelligence et le cœur de sauver ce pauvre petit papa de sept ans d’un désastre dont pas une seule fois je ne l’ai entendu parler, mais sur lequel il a dû construire toute sa vie et déjà, probablement, une partie de sa mort », par suicide, en 1983, lorsque son fils avait seize ans.
« Le jour même de sa mort, j’ai voulu écrire sur son suicide, sur ce qui venait de se passer. » Et ce désir n’a vraiment abouti qu’aujourd’hui, en 2025, avec la publication de La Maison vide.
Le piano
La singularité de la famille Proust ne tient pas qu’à l’héroïsme guerrier de ses hommes ou à leur capacité à réussir socialement. Marie-Ernestine, la fille de Firmin, révèle pendant son éducation chez les sœurs, un étonnant talent pour le piano qu’elle ne peut accomplir selon ses désirs en passant le concours du Conservatoire de Paris. Pendant des décennies, le Bösendorfer, magnifique piano à queue acheté par Firmin en échange de son renoncement à « des rêves de vie qui n’existent pas et n’existeront jamais dans nos campagnes » demeure son unique refuge.
Lorsque le père de Laurent Mauvignier ouvre à ses enfants et leurs cousins la maison, vide de tous les ancêtres qui l’ont désertée, ils sont happés par la présence d’un objet. « Je ne sais pas ce qui nous arrive, cette beauté, cet émerveillement ; on regarde, on se tait, on se dit chacun pour soi-même […] Oh, le piano. Le piano le piano le piano ».
Ce sont les ultimes mots du livre.
Références
Laurent Mauvignier, La maison vide, Éditions de Minuit, 744 p., 2025.
- Prix Littéraire Le Monde 2025
- Prix des libraires de Nancy – Le Point 2025
- Prix Landerneau 2025
- Prix Goncourt 2025
Partager cet article
Laisser un commentaire
Vous aimerez peut-être…
Pour être informé des dernières nouvelles,
abonnez-vous à la lettre d’info !
Une fois par mois, découvrez l’actualité des ateliers d’écriture, mes nouvelles publications de ressources et les nouveautés de mon journal de bord.


