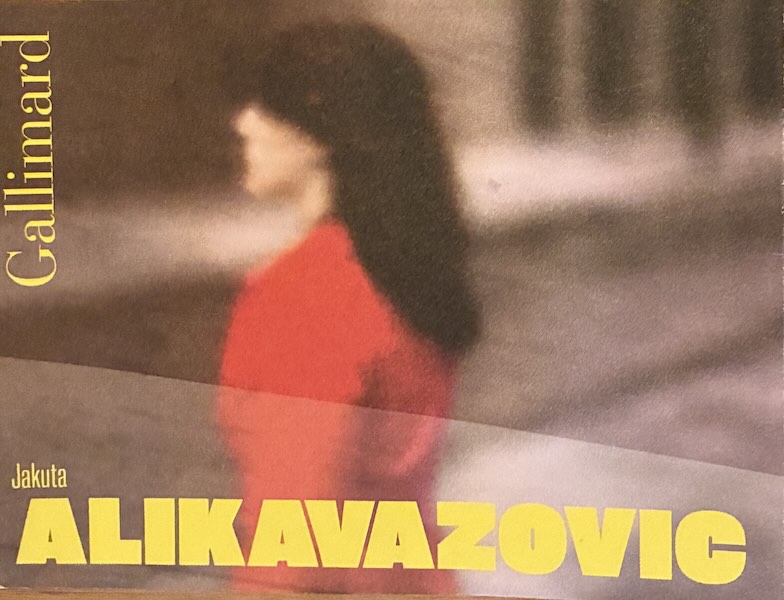
Comment vit-on face à l’incertitude d’un pays originel disparu, de parents venus d’ailleurs, portés par un grand désir d’intégration tout en protégeant les secrets de famille, aimant les belles choses qui cachent leur pauvreté d’émigrants ? Comment construit-on sa vie en fuyant une mère qui demeure une énigme parce que la parole n’a jamais circulé entre elle et sa fille ? « Longtemps, je n’ai rien eu à dire sur ma mère, explique la narratrice. Elle tenait dans une poignée de faits et quelques injonctions. » À l’instant où la mère disparaît, la fille s’engage dans une narration salvatrice, faite de répétitions, de retours en arrière, d’évocations d’une tuerie de masse au fond de la forêt yougoslave ou, en France, d’un groupe « de jeunes gens qui voulaient changer le monde » avec comme mot d’ordre « Ralentir. S’arrêter ». Le pouvoir de ce récit aux multiples méandres est tel que le lecteur s’embarque sans efforts avec la narratrice dans cette quête, cette « découverte d’un monde qui s’ouvre sur l’idée d’un avenir possible. Possible malgré tout ».
Agir en poésie
Agir en poésie
« Je suis allée à l’enterrement de Jean-Paul Sartre. J’ai appris le français toute seule : bien que je sois née à Paris, ce n’était pas la langue de notre foyer. » C’est ainsi que se présente la narratrice, fille d’une poétesse serbo-croate venue en France en 1972. Elle ne pouvait donner à sa fille le français en héritage. Elle l’a néanmoins intronisée dans la littérature française, en lui faisant suivre, bébé, le cercueil de Jean-Paul Sartre, parmi les milliers de personnes qui l’ont accompagné de l’hôpital Broussais au cimetière du Montparnasse, le 19 avril 1980. Cette initiative maternelle peut être considérée comme un geste poétique, une manière d’agir en poésie, même après avoir abandonné la création littéraire. Le premier des recueils publiés par la mère, en 1971, lui avait valu une grande célébrité dans son pays. Mais après son arrivée en France, et la disparition de la Yougoslavie dans la guerre, elle a cessé d’écrire, se vouant à des tâches domestiques et même parfois ancillaires pour gagner sa vie.
Pourquoi cesse-t-on d’écrire ? Pourquoi rejoint-on le groupe des écrivains fantômes qui hantent la littérature ? À cette question Jakuta Alikavazovic propose de multiples réponses, y compris celle selon laquelle « le talent poétique [de la mère] c’est manifesté ailleurs », y compris dans « sa vie, sa vie à elle [la narratrice] » qui serait ainsi la dernière œuvre » de sa mère.
La lumière est un des « fils conducteurs » qui guide le lecteur au milieu des multiples récits variant le thème de la mère disparue. Elle a tout fait pour offrir à sa fille une vie « sans horreur et sans servitude ». Et dans leur petit appartement, elle a ainsi créé une ambiance de clair-obscur, effaçant, par des abat-jours aux teintes douces, les signes de pauvreté et de précarité.
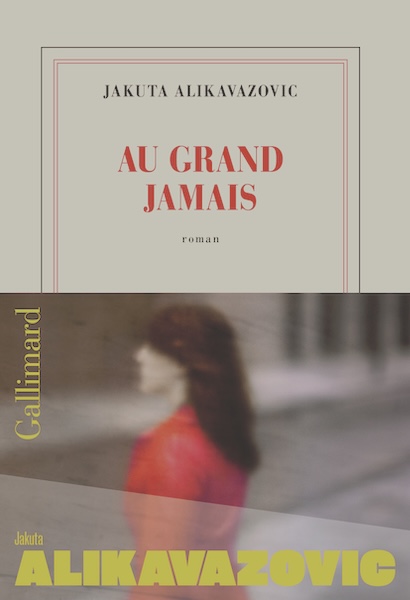
Je crois qu’il n’y a pas de lumière en ce monde
Sinon ce monde
Et je crois que la lumière est
George Oppen, cité par Jakuta Alikavazovic, (Au grand jamais, p. 235)
« Quelle histoire nous racontons-nous pour nous aider à vivre ? »
Au cours de son parcours sur les traces de ses ancêtres yougoslaves, la narratrice parvient à remonter jusqu’aux origines du « don » si souvent invoqué par la mère comme un dangereux secret : « Il y a un don dans notre famille » répètait-elle, tout en refusant d’en dire plus.
La narratrice dévoile elle aussi, pas à pas, les moments de sa propre existence qu’elle préserve comme ses souvenirs les plus précieux : les personnages les plus marquants – Sacha, mais aussi ce Thomas qu’elle cherche partout -; des scènes douloureuses, pour ne pas dire traumatisantes (car une part en demeure occultée); « le rêve d’une enfance infinie, d’une passion infinie, d’un accord parfait où toutes les périodes du cœur et du corps sont mêlées, où toutes les erreurs du temps et de l’histoire sont abolies. »; une phrase volée dans un poème de sa mère, offerte à un jeune activiste pour le placer dans un tract, reprise ensuite sur les murs comme un emblème « Rendons son obscurité à la nuit ».
Elle a appris que « rien n’est sûr en ce monde, et rien n’est stable, et le mur le plus épais s’écroule, et la vitre la plus solide redevient le sable qu’elle a été, et tout en ce monde peut nous être enlevé d’un souffle, disparaître en une nuit, tout, les corps aimés, les plus grandes bibliothèques, tout ce que l’on croit solide, durable, n’est que vapeur. […] Ce à quoi l’on tient, mieux vaut l’incorporer. Les seuls endroits où certaines choses peuvent survivre sont les têtes et les cœurs. Et c’est par cœur que l’on doit connaître ce qui est utile et ce qui est précieux. Les itinéraires de secours, en cas d’incendie. Son numéro de passeport. Une poignée de numéro de téléphone. Les façons de construire un abri pour échapper à la nuit au-dehors. Et un ou deux poèmes, pour échapper à la nuit au-dedans ».
En ensuite… peut-être pourra-t-on « réinventer un avenir. » Ce dont « on a tous besoin en ce moment » conclut Jakuta Alikavazovic.
Références
- Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard, 250 p., 2025.
Compléments à cet article
- « Mère et mystère avec Jakuta Alikavazovic », entretien par Marie Richeux, Book Club, France Culture, 27 août 2025
- Cécile Dutheil de la Rochère, « Rendons son obscurité à la nuit », En attendant Nadeau, 23 août 2025, n°225
Partager cet article
Laisser un commentaire
Vous aimerez peut-être…
Pour être informé des dernières nouvelles,
abonnez-vous à la lettre d’info !
Une fois par mois, découvrez l’actualité des ateliers d’écriture, mes nouvelles publications de ressources et les nouveautés de mon journal de bord.


