
L’année (dite scolaire) 2024-2025 parvient à son terme, et avec elle la tentation du bilan. Mon neuvième voyage en Inde de novembre 2024 y figure à la première place. J’ai rassemblé, trié les éléments rapportés de ce voyage, des photographies et notes qui gardent trace des événements vécus, de rencontres inédites et de sites visités dans les conditions exceptionnelles. En voici cinq évocations, celles qui se sont imposées parmi tant d’autres !
Un circuit à travers trois États d’Inde du Sud
Karnataka – Kerala – Tamil Nadu. J’ai donc à nouveau parcouru ces trois États pendant un mois, avec deux couples d’amis. L’un d’entre eux a fait partie des pionniers, de ces occidentaux qui depuis les années 1970 ne cessent d’interroger l’Inde, sa culture, ses mythes sur des questions d’ordre philosophique et spirituel : « Nous sommes un certain nombre, en Europe, à qui ne suffit plus la civilisation d’Europe ». Dès 1922, Romain Rolland avait lancé cette phrase, violemment controversée dans des nations encore dominées par l’idéologie coloniale. Depuis, le paysage mondial a été totalement bouleversé. Avec ses 1,4 milliard d’habitants, l’Inde devrait se hisser dès 2030 au rang de troisième économie mondiale, dépassant l’Allemagne et le Japon.
L’Inde du premier ministre Narendra Modi est ainsi caractérisée par une croissance économique fulgurante, par une modernisation galopante, par la création de mégapoles invivables du fait de la pollution, du manque d’eau, de l’accumulation des déchets, d’embouteillages inextricables. Les paysages sont bouleversés par l’implantation – Vite ! Toujours plus vite ! – d’infrastructures de transport gigantesques. Les indéniables progrès sur la misère, jusque dans les détails de la vie quotidienne (comme l’accès, enfin, à des toilettes pour une majorité de la population ou l’interdiction du tabac appliquée sur tout le territoire) sont obtenus par des méthodes autoritaires souvent critiquées mais extrêmement efficaces. Le parti de Narendra Modi, le BJP (Bharatiya Janata Party, Parti du peuple indien) fonde son ancrage populaire sur l’idéologie de l’hindutva (hindouité) qui « met sous pression les minorités confessionnelles et fragilise le sécularisme et le multiculturalisme du pays »… et la réalité que sous-tend cette formule très politiquement correcte est très souvent d’une violence extrême. L’Inde tolérante où pouvaient s’incarner les rêves des pionniers occidentaux dans les années 1970 est menacée de disparition. Même si par endroits et par moments, ce pouvoir de l’Inde à atteindre chacun au plus profond du soi perdure, emportant ceux qui la fréquentent tous leurs sens en éveil dans la danse cosmique de Shiva régissant la marche du monde à l’échelle d’un univers sans limites de temps ni d’espace.
Bengalore, Rama et Hanuman
Au centre du plateau du Deccan, Bengalore était la plus grande ville de garnison britannique, réputée pour son climat agréable même au cœur de l’été. Au détour des années 1990, la cité-jardin arborée est devenue une technopole. Ses multiples quartiers se sont modernisés et l’urbanisation s’est développée hors de toute mesure. Quatrième ville la plus embouteillée au monde, avec des problèmes d’approvisionnement en eau inextricables, asphyxiée par la pollution, Bengalore préserve quelques oasis de verdure et de calme dans ses quartiers traditionnels et elle s’ouvre à l’hypermodernité dans les rues fréquentées jour et nuit par les jeunes informaticiens riches et branchés.
Au nord-ouest de la ville, le quartier d’affaires luxueux des hôtels Marriott et Sheraton réserve une surprise de taille. Au détour d’une rue s’élève une statue de 20 mètres de haut, représentant Sri Rama (le roi parfait, septième avatar de Vishnu, protecteur de l’univers) avec à ses pieds Hanuman le dieu-singe, guerrier aux incroyables exploits. Cette statue n’est pas un monument ancien sauvegardé pour sa valeur patrimoniale : elle a été inaugurée le 21 octobre 2024. Dans un quartier chic de la ville symbole de la modernité et du développement, nous nous retrouvons plongés au cœur d’une des épopées indiennes majeures écrites en sanskrit : le Ramayana, dont chaque indien connaît, depuis l’enfance, tous les épisodes.

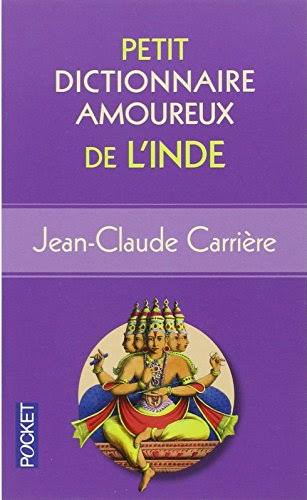
« Le goût de l’exploit, l’appel de l’espace, tous ces éléments parlent encore aujourd’hui de très près aux habitants de cette partie du monde. L’Inde est la plus épique des nations, sans doute aussi la plus pénétrée de mythologie. Un indien contemporain ne vit pas seulement dans le temps d’aujourd’hui. Il participe, qu’il le veuille ou non, à un autre temps, qui ne se mesure pas, qui n’a ni commencement, ni dates, ni peut-être de fin, et que les chants des épopées agitent tout autour de lui, quand il travaille et quand il dort ». Jean-Claude Carrière, Petit dictionnaire amoureux de l’Inde, Pocket, 2013, p.336
L’ashram sans gourou du sage Siddhartha
Né en Inde dans une famille chrétienne, Siddhartha a fait des études à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) à Paris. Journaliste engagé et leader social dans son pays, écologiste, militant de la cause des femmes et des tribus autochtones opprimées, il continue à intervenir sur la scène altermondialiste, particulièrement à Lyon où il participe aux Dialogues en humanité.
Il vit dans un domaine acquis par son père lorsqu’il n’était qu’une terre aride et inculte, dans la très grande banlieue de Bengalore. Ce « lieu-refuge » est désormais au cœur d’une forêt tropicale où il a développé une ferme biologique, un centre de rencontres interculturelles et interreligieuses portant le nom de Fireflies, les Lucioles, « métaphore appropriée – explique Siddhartha – pour ce que nous tentons de faire : créer des liens entre le visible et l’invisible, entre les voyages intérieurs et extérieurs, entre le rationnel et l’intuitif ». À partir du bâtiment d’accueil, un parcours conduit de bâtiment en bâtiment, jamais plus haut qu’un arbre, à travers des chemins minutieusement entretenus. Ce vaste espace au milieu de la nature est aussi une « cathédrale » vouée à l’accueil de toutes les sagesses à travers les œuvres d’artistes (sculpteurs, peintres), savamment ordonnancées. Elles conduisent pas à pas le visiteur vers la philosophie de Fireflies ancrée dans la conviction que pour agir sur la crise climatique, il faut « revenir à cette notion que la terre, notre première mère, est sacrée. »
Ainsi persiste, dans l’Inde de 2025, des lieux de paix et de dialogue comme cet « ashram sans gourou » où chacun peut faire ses propres choix. « Dans l’affaire, conclut Siddhartha, nous pourrions même sauver notre planète ! »

À Hampi, concert improvisé au bord de la rivière Tungabhadra
Le site archéologique majeur de 4100 ha connu sous le nom d’Hampi, est un ensemble monumental composite en ruines situé au milieu d’un paysage lunaire de rocs et collines, traversé de part en part par la rivière Tungabhadra.
À son apogée au XV° siècle, l’empire Vijayanagar fédérait tous les royaumes hindous du sud de l’Inde contre la pression des sultans musulmans du nord. La capitale de l’empire portait aussi le nom de Vijayanagar, « la cité de la victoire », et elle était décrite par les voyageurs persans, portugais ou italiens comme la plus grande, la plus belle et la plus riche de son temps. 500 000 habitants. Avec un immense marché couvert, de part et d’autre d’une très large allée s’ouvrant devant son temple principal et où s’échangeaient or, épices, bois de santal, riz, pierres précieuses… Pendant 200 ans, les constructions s’étaient développées de toutes parts : temples et sanctuaires, maisons et palais aux toits et murs couverts d’or et incrustés de joyaux, aqueducs, structures de défense militaire et lorsque vint la chute, en 1565, après la bataille de Talikota perdue face aux musulmans, les pillages et les destructions durèrent six mois.
Désormais inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité, Hampi est voué aux bouleversements et aménagements liés au « Master Plan » de transformation du site en zone touristique majeure. Il accueillera la déferlante des touristes indiens qui parcourent à grande vitesse les lieux de leur patrimoine restaurés et « ripolinés », en taxi ou en autocars.
Le béton n’a pas encore recouvert le chemin caillouteux en bord de rivière, qui relie les deux temples majeurs du site à travers des paysages merveilleux, presque inchangés depuis que les dieux ont investi ce site sacré à l’origine des temps, avant même l’ère des grandes épopées dont bien des scènes se sont déroulés ici.
Nous nous arrêtons au bord de la rivière, nous nous y asseyons sur des rochers pour mettre nos pieds dans l’eau, fraicheur bienvenue après la marche sous le soleil. Derrière nous, s’élève un « mandapa », édifice à colonnes dont les marches tombent dans la rivière. En son centre, une stèle, dédiée à Purandara Dasa, le père de la musique carnatique. Un couple s’approche et s’intéresse à notre petit groupe franco-indien. L’homme se présente en anglais : « Shreepad Patil, présentateur à News Anchor », une chaine de télévision réputée à Bengalore. Il engage, en kannada, la conversation avec notre ami indien. Avec un grand naturel, l’improbable se produit – en tout cas pour les occidentaux que nous sommes. Les deux hommes se mettent d’accord pour improviser un hommage à Puranda Dasa en chantant, l’un après l’autre, un des chants dévotionnels composés par le mystique du XV° siècle et qu’ils ont appris pendant leurs études, comme tout fils brahmane auquel sa famille s’attache à donner une éducation fidèle à leur rôle dans la société. Le présentateur de télévision et le vice-président d’une multinationale fabriquant des produits de haute technologie n’hésitent pas à honorer publiquement ce divin qui imprègne toujours leur existence, certes totalement investie dans le monde contemporain, mais néanmoins connectée à une autre dimension de l’univers…

Salman Rushdie, La Cité de la victoire, trad. Gérard Meudal, Actes Sud, 2023
Ce roman épique de Salman Rushdie mène tambour-battant le récit de la création, de la prospérité, des luttes internes fratricides et de la destruction de Vijayanagar. Rushdie demeure très fidèle aux grandes lignes de l’Histoire… mais il les fait passer à travers le prisme féministe, anti obscurantiste et pacifiste de ses convictions. Son récit est ponctué de notations sarcastiques, de réflexions politiques mais aussi d’épisodes magiques : la ville aurait ainsi été construite par Pampa Kampana, jeune orpheline dotée de pouvoirs extraordinaires par la déesse Parvati (que la tradition nomme aussi Pampa !), à partir de graines et de chuchotements à l’oreille des habitants pour leur transmettre les récits fondateurs de leur mémoire. Le « réalisme magique » prend ici tout son sens : les mythes fondent l’histoire de l’Inde tout autant, (sinon plus !), que les monuments archéologiques et les documents historiques.
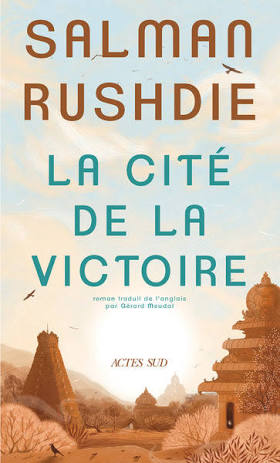

Gokarn, ville brahmane et plages de rêve
La menace de l’explosion touristique pèse aussi sur une autre Kshetra, ville sacrée fréquentée par les dieux depuis les origines de la planète. Le petit port de Gokarn était autrefois totalement investi par les pèlerins venus dans ce haut lieu de l’hindouisme shivaïte pour accomplir des rituels de purification et de libération, souvent liés à la mort : un temple qui surplombe le port rappelle que Rama lui-même, le héros du Ramayana, est venu à Gokarn pour se purifier d’avoir dû tuer Ravana, le ravisseur de son épouse Sita. Ses grandes plages servaient alors aux bains aux pélerins qui n’étaient pas tous autorisés à fréquenter, au centre du village, le « koti tirtha », le bassin de rétention à ciel ouvert d’une eau considérée comme sacrée : seuls les brahmanes avaient le droit de s’y tenir pour répéter 400 000 fois le mantra Gayatri (divinité solaire des védas), rituel qui permettait d’accéder à l’éveil…
Autour du tirtha, les maisons sont coquettes, colorées, manifestant que le lieu n’est plus seulement une ville de brahmanes uniquement voués à leurs préoccupations religieuses.
Le tourisme de masse (et les travaux gigantesques qu’il impose) approche : déjà les collines en un ou deux endroits ont été attaquées par des engins de travaux publics qui tranchent et aplanissent pour permettre la future construction de complexes hôteliers.
Mais les chemins qui dégringolent des reliefs vers les grandes plages entourées de cocotiers sont encore inaccessibles aux engins à moteur. Les jeunes branchés des grandes villes qui ont les moyens de venir y passer le week-end parviennent à y faire la fête mais… à Ôm Beach – oui « Ôm », c’est bien le nom porté par une de ces longues et larges grèves magiques ouvertes sur la mer d’Oman ! – à Ôm beach donc, au coucher du soleil, un homme s’est posé, quelques pas devant moi, assis en méditation et il est resté ainsi, dans un silence qui semblait avoir tout recouvert, face à ce mystère de la disparition de l’astre que les Upanishads (textes sacrés indiens) considéraient comme la Réalité suprême…
Pondichéry juste avant le cyclone
Comme pour beaucoup de Français, Pondichéry a été ma porte d’entrée en Inde, lors de mon premier séjour, en janvier 2009. Le charme désuet de cet ancien comptoir au statut toujours spécifique (Territoire dépendant directement du gouvernement fédéral) s’estompe peu à peu mais je retrouve mes repères familiers en arpentant à nouveau le quartier français au plan en damier le long de « Goubert Avenue », désormais « Beach Road ». Institut français, École française d’Extrême-Orient, Lycée français, Alliance française. Dans ces lieux de culture, j’ai rencontré de fascinants chercheurs imprégnés d’Inde tout autant que savants connaisseurs de ses mystères (linguistiques, architecturaux, religieux, coutumiers (des brahmanes aux intouchables)). Ils sont toujours présents et actifs, avec par exemple un projet européen sur des sources jusqu’ici négligées, intitulées « la religion de Shiva », apportant l’éclairage de la religiosité laïque sur la genèse de « l’hindouïsme ».
Les Français ont également été très présents dans le développement de l’ashram de Sri Aurobindo dont les bâtiments peints en gris résonnent, dans la ville blanche, avec ceux, peints en jaune, des institutions françaises. Libéré, en 1909, des prisons anglaises à Calcutta où des visions l’avaient conduit à une nouvelle naissance spirituelle, le bengali révolutionnaire Aurobindo Ghose n’était plus autorisé à vivre sur les terres de l’Inde alors britannique. Chandernagor était considéré comme trop proche de Calcutta. Sri Aurobindo et ses premiers compagnons s’installèrent donc dans un appartement d’un autre comptoir français, la petite ville de Pondichéry dans le lointain Tamil Nadu. Et lorsque les disciples affluèrent de plus en plus nombreux, c’est à une française, Mirra Alfassa, que Sri Aurobindo a confié, en 1927, le développement matériel et moral de l’ashram. À ses côtés, elle a joué un rôle spirituel fondamental dans l’évolution de la conscience humaine à laquelle doit mener la voie du Yoga intégral. Celle qui est ainsi devenue la « Mère » a attiré par son charisme un nombre considérable de fidèles parmi lesquels des français : Philippe Saint-Hilaire (Pavitra), Bernard Enginger (Satprem), Cristof Alward-Pitoeff…
Toutes ces présences m’accompagnent pendant que je marche, en notant les nombreux changements de ce quartier privilégié, lui aussi atteint par les effets de la période post-COVID, par les exigences du développement économique et les turbulences politiques. En cette journée de fin novembre, le bord de mer est secoué par une agitation inhabituelle… l’accès à la grève est interdit. Les coups de sifflet incessants des gendarmes en képi rouge (un des derniers héritages de la présence française !) troublent le calme de ce lieu de promenade, interdit aux voitures aux heures où se croisent familles indiennes, ashramites, chercheurs, touristes, mais aussi dirigeants et employés de commerces, d’hôtels et de restaurants, promoteurs immobiliers, entrepreneurs de projets économiques. Aujourd’hui, la maréchaussée s’agite pour faire respecter les mesures de précautions, mais aucun affolement n’est perceptible dans la population. On s’assoie face à la mer. Calmement. On attend. On espère que le cyclone restera à distance, évitera Pondichéry, comme à plusieurs reprises dans la période récente…
À notre départ Pondichéry, l’attente perdurait. Deux jours plus tard, alors que nous avions atteint Bengalore nous avons appris que les grosses pluies et les vents tempêtueux de mousson avaient évolué en cyclone : routes coupées, rues et maisons inondées, effondrements de terrains meurtriers, aéroports fermés sur toute la côte de Coromandel.
Cette fois, Pondichéry s’est retrouvé au cœur du cyclone…

Ce texte extrait certains éléments d’une conférence présentée le 5 juin 2025 sous l’égide de l’association culturelle CAEL (Plougrescant)
Partager cet article
Laisser un commentaire
Vous aimerez peut-être…
Pour être informé des dernières nouvelles,
abonnez-vous à la lettre d’info !
Une fois par mois, découvrez l’actualité des ateliers d’écriture, mes nouvelles publications de ressources et les nouveautés de mon journal de bord.



Quel retour en arrière vous me faites faire par ce partage. J’ai voyagé 5 fois en Inde de 2016 à 19 du Ladakh au Tamil Nadu, de Goa à l Arunachal Pradesh, visité Delhi, assisté à un Karnataka avec le dalaï lama .
Et tous ces souvenirs sont encore en vrac dans des cartons en attente d être mis en écriture…